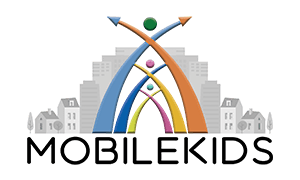Synthèse des résultats MobileKids : volet belge
Le présent rapport présente de manière synthétique les principaux résultats transversaux de notre projet MobileKids, une recherche en sociologie qui vise à comprendre la manière dont l’hébergement alterné égalitaire (HAE), et la mobilité et la multilocalité qui découlent de ce type de réorganisation familiale post-divorce, affectent les enfants âgés de 10 à 16 ans. Plus précisément, il s’agit de comprendre comment ces (jeunes) adolescents s’accommodent (ou pas) de ce mode de vie marqué par l’alternance entre deux lieux de vie, de mettre au jour la diversité des expériences vécues par ces enfants, et d’identifier leurs besoins, à partir de leurs propres récits. Cela implique de déterminer comment, et dans quelles circonstances, ces jeunes s’approprient ce mode de vie et développent de nouvelles manières d’agir et d’être au monde, des « habitus » (Bourdieu, 1979, 1997) spécifiques à la multilocalité, à la mobilité et à l’expérience de coprésences et absences intermittentes.
Avant d’entrer dans le vif du sujet de l’expérience vécue de l’hébergement égalitaire, le rapport contextualise l’hébergement égalitaire en Belgique au travers de 4 thématiques :
Le contexte législatif belge et la part d’hébergement égalitaire au sein de la population des familles divorcées ou séparées ; les résultats d’une enquête menée auprès de juges et avocats familialistes qui permet de dégager les principaux critères mobilisés pour évaluer les demandes d’hébergement égalitaire, ainsi que les représentations normatives de la famille qui informent l’évaluation des demandes et la motivation des refus d’un HE ; une analyse de la manière dont les politiques familiales belges intègrent les situations d’hébergement égalitaire, et les chiffres saillants qui ressortent d’une enquête administrée en 2018 auprès de 1500 adolescents scolarisés dans l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles – parmi lesquels 158 vivent en HE.
Nous présentons ensuite les grandes lignes des résultats d’une recherche qualitative, approfondie menée auprès de 21 jeunes en FWB. Nous y montrons que le fait de vivre dans et entre des lieux de résidence distincts implique que les jeunes font face à des obstacles et des difficultés dans leur quotidien (comme le poids physique que représente le transport de leurs affaires personnelles, le manque affectif éprouvé à l’égard d’un parent pendant les jours d’absence, la distance à parcourir entre les domiciles, le fait de jongler entre des cultures familiales différentes voire contradictoires, etc.). Cependant, en étant socialisés dans cet environnement particulier, les enfants que nous avons rencontrés développent des compétences, des stratégies et des manières d’être et de faire, spécifiques à ce mode de vie multilocal, qui les aident à faire « avec » ces périodes d’absence et de présence. Ces pratiques intègrent les différents espaces de résidence envisagés comme distincts l’un de l’autre, et les mettent en relation pour former un ensemble, un sens du chez-soi englobant et unique. Loin de vouloir prendre l’appropriation de ce mode de vie pour acquis, il s’agit ici de comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette appropriation. En effet, nous expliquons également comment certaines pratiques sont facilitées ou, au contraire, rendues difficiles, voire impossibles, par des conditions matérielles, culturelles, sociales, temporelles… qui forment conjointement une structure d’opportunités et de contraintes avec laquelle les jeunes doivent composer au quotidien. Le rapport se clôture sur quelques points saillants de la recherche relevés lors de focus groups avec des acteurs institutionnels et de terrain, ainsi que sur une série de recommandations issues de ces échanges.
Pour consulter le rapport :
Social Share:
Auteur: